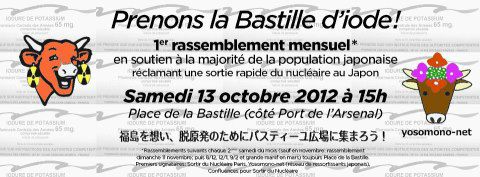Juillet 2012
1er juillet
Japon : la compagnie Kansai Electric Power annonce le redémarrage du réacteur n°3 de la centrale d'Ohi. La réaction en chaîne a été réactivée. Au même moment, plusieurs centaines de personnes campent toujours devant la résidence du premier ministre.
3 juillet
France : le groupe EELV est reçu par la ministre de l'Ecologie. A la sortie, il se dit de nouveau confiant… sans précision.
Espagne : la centrale de Garoña, mise en route en 1971, voit son activité prolongée jusqu'en 2019 ! Vives réactions des opposants.
4 juillet
Japon : le réacteur n°3 de la centrale d'Ohi est rebranché au secteur et recommence à produire de l'électricité. A l'extérieur de la centrale, des centaines d'opposants manifestent depuis le 29 juin. Elle fonctionne dans les mêmes conditions qu'avant l'accident de Fukushima. Comme si rien ne s'était passé…
Japon : selon le groupe d'information économique Nikkei, il y aurait actuellement plus de 100 parcs photovoltaïques (entre 1 et 100 MW) en construction dans le pays.
5 juillet
Japon : la commission parlementaire chargée d'étudier la part du séisme et du tsunami dans la catastrophe de Fukushima a remis un rapport de 620 pages. Elle conclut intelligemment en rappelant que c'est d'abord une catastrophe créée par l'homme… "L'accident (..) est le résultat d'une collusion entre le gouvernement, les agences de régulation et l'opérateur Tepco, et d'un manque de gouvernance de ces mêmes instances". Il y a bien eu un séisme et un tsunami… mais leurs effets ont été terribles car les travaux prévus de longue date pour s'en protéger n'ont pas été effectués pour des raisons purement financières. Cette enquête donne des informations fort différentes des rapports lénifiants de TEPCO, jusqu'alors les seuls disponibles. Le rapport remet en cause la version selon laquelle c'est le tsunami qui a provoqué l'accident. Les témoignages recueillis montrent au contraire que le séisme a sûrement largement contribué à entamer le processus de la catastrophe. Ce dernier point est important : cela signifie qu'un réacteur, même éloigné des côtes (comme c'est le cas en France, mais pas au Japon) peut subir un accident similaire avec seulement un fort séisme.
la catastrophe nucléaire de Fukushima
Re: la catastrophe nucléaire de Fukushima
Re: la catastrophe nucléaire de Fukushima
A Fukushima, les habitants vivent à l’heure de la séparation 13.08 Brigitte Bègue
Le 7 août dernier, en pleine commémoration de l’explosion des bombes sur Hiroshima et sur Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, trois citoyens japonnais en provenance de Fukushima sont venus rendre compte à Paris de leur quotidien. Une rencontre à l’initiative des journalistes de l’environnement (Aje). Ils sont tous membre du CRMS (Citizen’s radioactivity measuring station), un réseau que les habitants de Fuskushima ont mis en place avec l’aide de la Criirad (organisme indépendant de mesure de la radio-activité qui s’est crée au moment de Tchernobyl) pour faire face à la désinformation du gouvernement japonais sur l’ampleur de la catastrophe.
« Comme on ne nous donnait pas de chiffres sur la radioactivité, les habitants de FuKushima se méfaient de plus en plus, raconte la présidente du CRMS, Aya Marumori. Les autorités nous disaient que si nous étions malades plus tard, ce serait à cause de notre stress et non de la radioactivité. Dans ce contexte, la population a commencé à se taire. Et aujourd’hui, c’est encore ça qui prédomine. Nous n’avons pas le droit de dire notre inquiétude. Du coup, les gens s’autocensurent, les jeunes mamans et les femmes enceintes se sentent pourtant insécurisées. Mais on nous répond toujours qu’il n’y a aucun problème ». En juillet 2011, les habitants se prennent par la main pour créer le CMRS. Objectif : réaliser des mesures indépendantes de la radioactivté dans l’air, sur les aliments, dans les écoles, les habitations, les crèches, les sols, etc. L’association a également acheté un appareil qui puisse mesurer directement sur le corps les doses reçues par les citoyens. « Des médecins et des pédiatres nous soutiennent, souligne Aya Marumori. Nous avons déjà organisé des visites médicales gratuites huit fois et mille personnes sont venues consulter ». Pour chaque famille, « un carnet de vie », sorte de carnet de santé est établi afin de suivre leur état dans les années qui viennent. Neuf stations de mesures ont déjà été installées dans la préfecture de Fukushima et une antenne a été mise en place à Tokyo.
Des conséquences sur la santé encore inconnues
« On ne peut pas encore savoir l’impact de Fukushima sur notre santé, les gens ont beaucoup de symptômes, surtout chez les enfants, mais on ne sait pas si c’est lié à l’explosion de la centrale. Les parents nous disent par exemple, qu’avant, quand leurs enfants étaient enrhumés, ils guérissaient plus vite que maintenant. Est-ce lié à une baisse du système immunitaire ? Des enfants ont eu des examens de leur thyroïde à l’hôpital mais nous n’avons pas encore les résultats », déclare Wataru Iwata, directeur du laboratoire CMRS. Kodai Tanji, lui, vivait chez ses parents avec sa femme et ses deux enfants, dans le quartier de Watari, à l’est de Fukushima quand la catastrophe a eu lieu : « J’avais entendu parler des pastilles d’iode mais je n’ai pas pu m’en procurer. Avec ma famille, on a vécu enfermé trois jours, j’avais interdit à mes enfants de sortir de la maison. Ma mère était tellement angoissée qu’elle a encouragé ma femme et les enfants à partir. Le 14 mars, alors qu’on préparait le dîner, j’ai appelé un taxi pour les envoyer à Tokyo. Il n’y avait plus d’essence ni de train à Fukushima, tout était bloqué, c’était cher mais la seule solution. Le 15 mars, j’avais tellement peur moi aussi que je suis parti les rejoindre ». La famille de Tanji est partie ensuite se réfugier dans un village entre Osaka et Tokyo, « C’est comme si on faisait une course poursuite avec le nuage radioactif », dit-il.
Les mères et les enfants partent
Aujourd’hui, sa femme, Yayoi et leurs enfants de 11 et 9 ans, vivent au sud du Japon, à 600 kms de lui, chez les parents de Yayoi. « Au début, on se téléphonait tous les jours, mais ça finit par coûter cher, raconte-t-elle. Mon mari vient nous voir une fois tous les deux mois en TGV ou en voiture. Jusqu’à mars 2012, les réfugiés pouvaient utiliser l’autoroute gratuitement mais aujourd’hui, il faut payer 120 euros un aller simple, les autoroutes sont très chères au Japon, et il doit faire huit heures de route ». Quand pense-t-elle rentrer ? « Je ne sais pas, cela peut encore exploser à Fukushima, j’ai peur ». « Watari était un beau quartier avec ses cerisiers qui donnaient 40 000 cerises au printemps mais il est aujourd’hui très contaminé », déplore Kodai. Pourtant, les autorités n’ont pas cru bon d’évacuer les habitants. La zone d’évacuation obligatoire a été délimitée à 20 kms autour de la centrale, au-delà, c’est parfois recommandé quand on est à 30 kms, par exemple, ou qu’on habite un « spot » de haute contamination comme c’est le cas pour Watari mais, sans obligation de partir, la population doit se débrouiller seule.
Deux foyers évacués
Sur 300 000 habitants à Fukushima, environ 161 000 ont quitté leur habitation : 100 000 sont, néanmoins, restés à l’intérieur de la préfecture, les autres sont partis beaucoup plus loin. Comme Yayoi, la plupart des réfugiés volontaires sont des mères et des enfants, les pères sont restés à Fukushima pour travailler. A Watari, les autorités ont conclu que deux foyers seulement devaient être évacués. Pourtant, selon le CMRS, 309 sont contaminés au-delà du seuil. « Pourquoi tous les habitants ne sont-ils pas traités de la même manière, pourquoi devons-nous attendre la décontamination par l’Etat, pourquoi ne sommes-nous pas évacués et indemnisés », interroge Kodai Tanji. Seuls ceux qui ont de l’argent peuvent quitter Fukushima Aujourd’hui, le CMRS se bat, entre autres, pour que les réfugiés volontaires puissent être aidés financièrement : ceux qui été évacués par le gouvernement perçoivent mille euros d’indemnités par mois auxquels s’ajoutent un dédommagement pour les frais médicaux, de déplacement et de première nécessité (électricité, gaz, etc.). Les réfugiés volontaires n’ont eu droit qu’à 6000 euros par enfant et 800 euros par adulte. Du coup, seules les familles qui ont un peu d’argent, comme celle de Tanji, peuvent fuir FuKushima, les autres sont condamnés à subir la pollution radioactive. Une loi votée par le parlement japonnais le 21 juin dernier devrait bientôt permettre aux habitants de Fukushima qui veulent quitter la zone de réclamer des indemnités. « Encore faut-il qu’elle soit appliquée et que le seuil de radioactivité au-delà duquel on estime qu’il y a danger pour leur santé soit correctement défini par les autorités », insiste Wataru Iwata. Ce qui semble loin d’être le cas. D’autant que comme il le souligne « la radioactivité n’est pas là même partout : elle est plus importante près du toit qu’au rez-de-chaussée des maisons ».
Re: la catastrophe nucléaire de Fukushima
Japon : Je suis en colère Michel Bernard Journaliste à la revue Silence
Je suis en colère parce que l'accident de Tchernobyl n'a pas servi de leçon. Et que l'on continue à entendre et lire les mêmes mensonges sur le nucléaire dans les médias.
Je suis en colère quand j'entend à la radio, un haut responsable du nucléaire français nous dire qu'on ne peut remettre en cause le nucléaire : "personne n'a envie de revenir à la bougie". Que je sache, dans les pays européens qui n'ont pas de centrales nucléaires (Autriche, Danemark, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal…), y-en-t-il où l'on s'éclaire à la bougie ? Il n'y a que 441 réacteurs nucléaires dans le monde (dont 58 en France, 55 au Japon)… dans seulement 31 pays, tous les autres pays s'en passent.
Je suis en colère quand en 1979, après l'accident nucléaire de Three-Mile Island, on nous a dit que c'était parce que les Américains étaient moins forts que nous ; quand en 1986, après l'accident de Tchernobyl, on nous a dit que les Russes étaient moins foirt que nous… et que je lis aujourd'hui que les Japonais sont moins forts que nous… De qui se moque-t-on ?
Je suis en colère quand on me dit que l'on peut continuer à exploiter encore des vieux réacteurs comme Fessenheim en Alsace (qui a trente ans) parce que "plus il est vieux, mieux on connait un réacteur". Ce n'est pas parce que vous connaissez bien les défauts de votre vieille voiture qu'elle tombe moins souvent en panne et moins gravement. (Le réacteur Fukushima-Daiichi 1, qui vient d'exploser avait 40 ans et a été autorisé à continuer de fonctionner pour dix ans en février 2011 !).
Je suis en colère quand on nous dit que l'on ne peut se passer du nucléaire en France, parce que cette énergie fournit près de 80 % de notre électricité. C'est oublier que l'électricité n'est pas la principale source d'énergie (c'est le pétrole) et que le nucléaire ne représente que 17 % de notre énergie. Si l'on voulait s'arrêter, on pourrait s'appuyer sur une solidarité au niveau de l'Europe : là, le nucléaire ne représente que 35 % de l'électricité et seulement 9 % de l'énergie ! Il suffirait donc d'économiser 9 % pour s'en passer !
Je suis en colère parce qu'au nom de la défense de la croissance économique, les programmes énergétiques français ou européens, négligent toujours plus ou moins le potentiel des économies d'énergies, préférant la surconsommation, éventuellement alimentée par le recours aux énergies renouvelables. Or l'énergie la plus propre reste celle que l'on ne consomme pas. En adoptant les meilleures techniques disponibles et en évitant les comportements énergivores, nous pourrions diviser par 4 notre consommation en une vingtaine d'années.
Je suis en colère parce que les discours économiques nous polluent : on nous dit qu'arrêter un réacteur nucléaire, ce serait de l'argent gaspillé… mais les 1000 milliards d'euros déjà dépensé en 25 ans pour la gestion de la catastrophe de Tchernobyl (et c'est loin d'être terminé), ce n'est pas un gaspillage encore plus grand ? Mille milliards d'euros, c'est sensiblement le coût qu'il a fallut dépenser pour construire l'ensemble des 441 réacteurs actuellement en fonctionnement.
Je suis en colère parce que je sais que l'on peut arrêter relativement rapidement le programme nucléaire français, qu'il existe de multiples scénarios de sortie sur le sujet (de 2 à 30 ans selon les efforts qu'on veut bien consentir).
Je suis en colère quand j'entends mon gendre, 25 ans, ingénieur dans le photovoltaïque, me dire qu'il cherche un nouveau travail car la profession est sinistrée suite aux récentes décisions du gouvernement.
Je suis en colère quand mon fils, 20 ans, me dit : "à quoi ça sert de faire des études si dans cinq ans on a tous un cancer" (et il ne pense pas qu'au nucléaire, mais aussi à la pollution atmosphérique, aux pesticides…).
Alors j'agis, je me suis investi depuis une trentaine d'années dans les médias écologistes pour faire circuler une information moins déloyale et j'incite les journalistes et les lecteurs à prendre le temps d'eux aussi chercher où est la vérité. Comment peut-on encore minorer l'importance de la pollution radioactive au Japon alors que les images sur internet nous montrent les réacteurs en flamme ?
Alors j'agis et je m'engage dans l'une des 875 associations qui animent le Réseau Sortir du nucléaire pour demander à nos élus de faire pression pour un changement de politique dans le domaine de l'énergie. (www.sortirdunucleaire.org)
Alors j'agis au niveau local en rejoignant les nombreux groupes locaux qui travaillent à des plans de descente énergétique qui nous permettront de diminuer la menace nucléaire, mais aussi notre dépendance à un pétrole qui va être de plus en plus rare. (www.transitionfrance.fr)
Alors j'agis car aujourd'hui si le lobby nucléaire arrive à manipuler élus et médias, c'est parce que nous ne nous indignons pas assez !
Re: la catastrophe nucléaire de Fukushima
Les papillons mutants de Fukushima France 2 (vidéo) Gaëlle LE ROUX (texte)
Un an et demi après la catastrophe de Fukushima, des biologistes japonais ont mis en évidence une mutation génétique chez des papillons exposés aux radiations. L’étude ravive les inquiétudes sur les conséquences humaines de l’accident nucléaire.
Les zizeeria maha, des petits papillons bleus, étaient jusqu’alors considérés comme particulièrement résistants aux effets de la radioactivité. Mais un an et demi après l’accident nucléaire de Fukushima, des scientifiques japonais ont révélé des mutations génétiques chez ces insectes, capturés à proximité de la centrale et particulièrement exposés aux radiations. L’étude a été rendue publique mardi 14 août dans la revue "Scientific Reports".
Six mois après la catastrophe nucléaire de Fukushima, plus de la moitié des papillons capturés dans la zone contaminée présentaient des malformations, notamment au niveau des ailes.
Les biologistes ont d’abord capturé un groupe de 144 papillons dans dix endroits différents du Japon, dont la région de Fukushima, deux mois après l’accident nucléaire de mars 2011. Ils étaient à l’état de larve au moment de la catastrophe. Les spécimens collectés près de la centrale endommagée ne présentent pas, selon l’étude, un taux de malformation différent des autres. En revanche, 18 % des papillons de la génération suivante, nés du croisement d’insectes sains et d’insectes exposés aux radiations, sont anormaux. Ils ont notamment des antennes atrophiées, des malformations des pattes, des lésions au niveau des yeux et des ailes…Ce chiffre passe à 34 % pour la génération d’après. Six mois après la catastrophe, plus de la moitié des papillons capturés lors d’une seconde opération près de la centrale de Fukushima présentent des anomalies morphologiques.
Les papillons, de l'espèce zizeeria maha, présentaient aussi des lésions au niveau des yeux, des pattes et des antennes.
En exposant à des radiations des papillons non affectés préalablement, les scientifiques sont parvenus à prouver que les malformations constatées chez les papillons de Fukushima étaient bel et bien dues aux émanations radioactives provoquées par l’accident nucléaire. "Nous en avons tiré la conclusion claire que les radiations dégagées par la centrale de Fukushima Daiichi avaient endommagé les gênes des papillons, assure Joji Otaki, professeur à l’université Ryukyu d’Okinawa, dans le sud du Japon. Nos résultats étaient inattendus : nous avons toujours cru que ces insectes étaient très résistants aux radiations."
Quid des effets chez l'être humain ?
Si les résultats de cette étude sont préoccupants, aucune conclusion générale sur l’impact de l’accident ne doit pour l’heure être tirée, précise le chercheur. L’effet observé n’est aujourd’hui avéré que sur les papillons, pas sur les autres espèces animales ou sur l’homme. Pourtant, nombre de scientifiques tirent la sonnette d’alarme quant aux effets probables de la catastrophe sur la santé humaine. Tim Mousseau, biologiste spécialiste de l’impact des radiations sur les animaux et les plantes à l’université américaine de Caroline du Sud, est l’un d’entre eux. "Cette étude est importante et bouleversante dans ses implications pour les communautés humaines et biologiques vivant à Fukushima", a-t-il déclaré sur la BBC.
Un papillon n'ayant subi aucune malformation.
Michel Fernex, médecin suisse, professeur de médecine à l’université de Bâle et ancien président de l’organisation Les enfants de Tchernobyl Belarus, s’en inquiète également. À son retour d’un récent séjour au Japon, où il a été invité par des associations de victimes de Fukushima, le professeur a témoigné d’impacts d’ores et déjà visibles sur les hommes, notamment sur les enfants. "J’ai pu rencontrer quatre professeurs [de l’université de médecine de Fukushima], raconte-t-il dans un entretien publié dans le quotidien "l’Alsace" fin juillet. Ils étaient très surpris de voir apparaître chez des sujets jeunes des infarctus du myocarde, du diabète, des maladies des yeux. […]. [Les études de l’institut indépendant Belrad auprès des populations touchées par Tchernobyl] ont mis en évidence les liens entre contamination, notamment par le Césium 137, et ces pathologies."
Il relate également l’apparition de maladies de la thyroïde. "Mais les cancers ont un temps de latence qui fait qu’ils ne séviront que dans quatre ans, tout comme les cancers du cerveau chez les enfants et plus tard chez les adultes", assure-t-il. Puis il poursuit : "Le nombre de bébés de faible poids à la naissance augmente. Le nombre de naissance de filles baisse de 5 % parce que l’embryon féminin est plus vulnérable". L’évolution des maladies du nouveau-né et du mongolisme reste en revanche inconnue. "Ces données sont gardées secrètes", affirme Michel Fernex. Comme pour Tchernobyl*, les chercheurs japonais subissent l’intimidation des autorités pour qu’ils ne poussent pas leurs études trop loin, selon le médecin. "Directive a été donnée à l’université de Fukushima de ne pas parler de nucléaire. Seul un jeune professeur d’écologie tente des études sur les conséquences de la catastrophe sur les enfants. Il subit des menaces", rapporte-t-il.
Bataille de chiffres
Plus de 26 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en avril 1986 en Ukraine, une bataille des chiffres est toujours en cours autour des conséquences sanitaires de l’accident. Les experts de l’ONU, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sont régulièrement accusés de fournir des bilans tronqués et des chiffres extraordinairement bas concernant le nombre de décès et maladies directement imputables à l’exposition des populations aux radiations, après l’accident.
"L'AIEA a deux missions: contrôler le nucléaire militaire et promouvoir le nucléaire civil, une entreprise qui commence par la négation des conséquences d'une catastrophe comme Tchernobyl", accusait ainsi Roland Desbordes, président de la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (Criirad) en 2005, au lendemain de la publication d’un rapport de 600 pages validé par huit agences de l’ONU, dont l’AIEA et l’OMS, qui n’imputait "que" 4 000 morts à l’accident de Tchernobyl.
Au Japon, aucune personne n’est décédée directement du fait des radiations provoquées par l’accident de Fukushima. Mais les habitants de la région et les travailleurs qui interviennent dans la centrale endommagée craignent des effets à long terme. Quatre études épidémiologiques ont été lancées dans le pays après la catastrophe. Elles devraient durer 30 ans. Aucune donnée médicale notable n’a, pour l’heure, été rendue publique. Parallèlement, l’équipe de biologistes auteure des études sur les papillons bleus s’attèle désormais à faire des recherches sur l’impact des radiations sur des animaux. Les résultats ne devraient pas être connus avant plusieurs années.
*Youri Bandajevskaïa, un médecin biélorusse travaillant sur les conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl, a été arrêté en 1999 puis condamné deux ans plus tard à huit ans de prison. Il avait démontré l’effet toxique du Césium 137, même à faible dose, sur les enfants et les adultes, et n’avait de cesse d’appeler son gouvernement à prendre des mesures pour protéger les populations.
Re: la catastrophe nucléaire de Fukushima
La dangereuse imposture nucléaire Jean-Jacques Delfour, professeur de philosophie en CPGE, ancien élève de l'ENS de Saint-Cloud
L'information commence à émerger : dans la centrale nucléaire de Fukushima, la piscine du réacteur 4, remplie de centaines de tonnes de combustible très radioactif, perchée à 30 mètres, au-dessus d'un bâtiment en ruine, munie d'un circuit de refroidissement de fortune, menace l'humanité d'une catastrophe pire encore que celle de Tchernobyl. Une catastrophe qui s'ajoute à celle de mars 2011 à Fukushima : 3 réacteurs percés qui déversent leur contenu mortel dans l'air, dans l'océan et dans la terre.
Les ingénieurs du nucléaire ne savent pas quoi faire face à tous ces problèmes. Ils ont déclamé que la sécurité, dans le nucléaire, était, est et sera totale, que, lorsqu'une catastrophe majeure a lieu, personne n'a de solution à proposer. Telle est l'effroyable vérité que révèle Fukushima. Tchernobyl avait été mis au compte de l'incompétence technique des Soviétiques. Impossible de resservir la même fable politique.
Si l'on fait usage de sa raison, il ne reste qu'une seule conclusion : l'incompétence des ingénieurs du nucléaire. En cas de panne du circuit de refroidissement, si l'échauffement du réacteur atteint un seuil de non-retour, il échappe au contrôle et devient un magma en fusion de radionucléides, de métal fondu et de béton désagrégé, très toxique et incontrôlable (le corium).
La vérité, posée par Three Miles Island, Tchernobyl et Fukushima, est que, une fois ce seuil franchi, les ingénieurs sont impuissants : ils n'ont pas de solution. Ils ont conçu et fabriqué une machine nucléaire mais ils ignorent quoi faire en cas d'accident grave, c'est-à-dire "hors limite". Ce sont des prétentieux ignorants : ils prétendent savoir alors qu'ils ne savent pas. Les pétroliers savent éteindre un puits de pétrole en feu, les mineurs savent chercher leurs collègues coincés dans un tunnel à des centaines de mètres sous terre, etc. Eux non, parce qu'ils ont décrété qu'il n'y aurait jamais d'accidents très graves.
Dans leur domaine, ils sont plus incompétents que les ouvriers d'un garage dans le leur. S'il faut changer le cylindre d'un moteur, les garagistes savent comment faire : la technologie existe. Si la cuve d'un réacteur nucléaire est percée et si le combustible déborde à l'extérieur, les "nucléaristes" ne savent pas ce qu'il faut faire. On objectera qu'une centrale nucléaire est plus complexe qu'une voiture. Certes, mais c'est aussi plus dangereux. Les ingénieurs du nucléaire devraient être au moins aussi compétents dans leur propre domaine que ceux qui s'occupent de la réparation des moteurs de voiture en panne : ce n'est pas le cas.
Le fait fondamental est là, affolant et incontestable : les radionucléides dépassent les capacités technoscientifiques des meilleurs ingénieurs du monde. Leur maîtrise est partielle et elle devient nulle en cas d'accident hors limite, là où on attendrait un surcroît de compétence : telle est la vérité, l'incontestable vérité. D'où l' aspect de devin à la boule de cristal des ingénieurs et des "spécialistes" du nucléaire. La contamination nucléaire ? Sans danger, affirment-ils, alors qu'ils n'en savent rien. L'état du réacteur détruit sous le sarcophage de Tchernobyl ? Stabilisé, clament-ils, alors qu'ils n'en savent rien. La pollution nucléaire dans l'océan Pacifique ? Diluée, soutiennent-ils, alors qu'ils n'en savent rien. Les réacteurs en ruine, percés, détruits, dégueulant le combustible dans le sous-sol de Fukushima ? Arrêtés à froid et sous contrôle, assurent-ils, alors qu'ils n'en savent rien.
Les effets des radionucléides disséminés dans l'environnement sur les générations humaines à venir ? Nuls, clament-ils, alors qu'ils n'en savent rien. L'état des régions interdites autour de Tchernobyl et Fukushima ? Sans nocivité pour la santé, aujourd'hui, comme pour des décennies, proclament-ils, alors qu'ils n'en savent rien. Pour qui les radiations sont-elles nocives ? Seulement pour les gens tristes, avancent-ils, alors qu'ils n'en savent rien. Ce sont des devins. L'art nucléaire est un art divinatoire. C'est-à-dire une tromperie.
Le nucléaire, qui s'annonçait comme la pointe avancée du savoir technoscientifique au point de se présenter comme une sorte de religion du savoir absolu, se révèle d'une faiblesse extrême non pas par la défaillance humaine mais par manque de savoir technoscientifique. Quelle que soit la cause contingente du dépassement du seuil de non-retour (attentat terroriste, inondation, séisme), l'incapacité de réparer et de contrôler la dissémination des radionucléides manifeste un trou dans le savoir qui menace la certitude de soi de la modernité. Les modernes prétendaient avoir rompu avec les conduites magiques. Le nucléaire est l'expérience d'une brutale blessure narcissique dans l'armature de savoir dont s'entoure l'homme moderne ; une souffrance d'autant plus grande que c'est sa propre invention qui le place en situation de vulnérabilité maximale.
En effet, le refus de considérer la possibilité réelle d'un accident hors limite a pour conséquence la négligence pratique et l'indisponibilité de fait des moyens techniques appropriés à ces situations hors limite. Ces moyens n'existent pas ; et personne ne sait si l'on peut les fabriquer. Peut-être qu'un réacteur en "excursion" est incontrôlable ou irrécupérable.
Je ne le sais pas et aucun "nucléariste" ne le sait; mais il est sûr que personne ne le saura jamais si l'on n'essaye pas de fabriquer ces outils techniques. Or l'affirmation d'infaillibilité empêche leur conception. Sans doute, ouvrir ce chantier impliquerait d'avouer une dangerosité jusqu'ici tue et de programmer des surcoûts jusque-là évités. Ainsi, l'infaillibilité des papes du nucléaire a plusieurs avantages : endormir les consciences et accroître les profits, du moins tant que tout va bien ; l'inconvénient majeur est de nous exposer sans aucun recours à des risques extrêmes.
Tout savoir scientifique ou technique est, par définition, incomplet et susceptible de modification. Affirmer l'infaillibilité d'un savoir technoscientifique ou se comporter comme si cette infaillibilité était acquise, c'est ignorer la nature du savoir et confondre celui-ci avec une religion séculière qui bannit le doute et nie l'échec. D'où l'effet psychotique de leurs discours (infaillibles et certains) et de leurs pratiques (rafistolages et mensonges). Tout observateur est frappé par cette contradiction et plus encore par son déni. Chacun est sommé d'un côté de leur reconnaître une science et une technique consommées et de l'autre côté de se taire malgré le constat de leur échec. Bref, le nucléaire rend fou. Mais ce n'est qu'un aspect de notre condition nucléaire. Contaminés de tous les pays, unissez-vous !
Re: la catastrophe nucléaire de Fukushima
Nucléaire : les 19 centrales françaises seraient épinglées par Bruxelles 01/10
Les résultats des stress-tests européens post-Fukushima du parc nucléaire français ne sont pas bons, selon Le Figaro qui affirme que le bilan note des "défaillances" pour toutes les centrales françaises mais n'exige aucune fermeture.
SURETE NUCLEAIRE - Il y a en France 54 réacteurs dans un total de 19 centrales. Elles sont toutes visées par les conclusion d'un test européen de sécurité des installations tenant compte de la catastrophe de Fukushima.
Des défaillances dans chaque centrale, mais aucune fermeture imposée. Ce serait le résultat du bilan par l'Union européenne des stress-tests post-Fukushima des 19 centrales nucléaires françaises, dont Le Figaro affirme avoir obtenu une copie.
D'après le journal, les centrales tricolores manquent d'instruments de mesure sismique répondant aux exigences de l'après-Fukushima et leurs équipements de secours ne sont pas protégés comme ceux des réacteurs des pays voisins. Des défauts qui ont cependant déjà été relevés par l'Autorité de sûreté nucléaire dans un rapport, et pour lesquels EDF a assuré que des solutions seront trouvées.
La plupart des critiques concernent les centrales françaises
Fessenheim, souvent pointée du doigt pour son statut de doyenne du parc, n'est pas la plus mal notée par le rapport. Le quotidien écrit que "les procédures prévues en cas d'accident grave sont jugées insuffisantes à Chooz et Cattenom mais adéquates à Fessenheim".
Ces tests de résistance et de sécurité sont menés depuis un ans sur ses 147 réacteurs répartis dans 14 pays, dont 58 en France dans 19 centrales.
Le cas d'un crash d'avion sur une centrale
"Nos contrôles de sécurité ont été stricts, sérieux et menés en toute transparence", a déclaré le commissaire à l'Energie Gunther Oettinger, en amont de cette information, ce lundi. " Ils ont permis de révéler ce qui allait bien et là où il fallait apporter des améliorations", a-t-il ajouté.
Avant de mettre en garde: la commission européenne ne montrera "aucune complaisance" sur la sécurité du parc nucléaire européen.
Selon le journal allemand Die Welt, qui dit avoir consulté ce rapport, le commissaire Oettinger chiffre à 25 milliards d'euros les travaux de mise en conformité rendus nécessaires par les contrôles qui ont fait apparaître des "centaines d'insuffisances". Die Welt précise d'ailleurs que la plupart des critiques concernent les centrales françaises.
La Commission européenne a réclamé des contrôles sur tous les types de réacteurs installés dans l'UE et a demandé une analyse des conséquences d'un accident d'avion sur une installation.
L'objectif était de vérifier la sécurité des installations en cas de rupture des approvisionnements en électricité, comme cela s'est produit sur le site de la centrale de Fukushima au Japon après le séisme suivi d'un gigantesque tsunami qui a inondé les installations.
Gunther Oettinger espère que la commission sera en mesure de soumettre ce rapport et ses recommandations aux dirigeants de l'UE lors du sommet des 18 et 19 octobre à Bruxelles.
Re: la catastrophe nucléaire de Fukushima
La centrale de Fukushima continuerait de fuir
Les niveaux élevés de radioactivité des poissons pêchés au large de la centrale de Fukushima pourraient indiquer qu'elle continue de fuir, 19 mois après la catastrophe nucléaire, selon l'étude d'un expert américain.
Dans cette étude publiée jeudi dans la revue américaine Science, Ken Buesseler, chimiste à l'Institut océanographique de Woods Hole (Massachusetts, nord-est des Etats-Unis), a analysé des mesures de césium effectuées par les autorités japonaises sur des poissons, des crustacés et des algues prélevés près de la centrale.
Les résultats, selon Buesseler, tendraient à prouver que les taux constatés sont provoqués soit par une petite fuite persistante de la centrale, soit par la contamination des fonds marins. C'est d'ailleurs dans des espèces dites démersales (vivant au contact du fond dans la zone marine littorale) que les plus importants niveaux de césium ont été relevés: rascasses, raies, congres, flétans, soles, etc.
Selon les conclusions de l'étude, environ 40% des poissons pêchés dans les environs de la centrale de Fukushima (nord-est) ne sont pas consommables selon les normes établies par les autorités nippones.
Le scientifique précise toutefois qu'au large du nord-est du Japon, au-delà de la zone la plus proche de la centrale, la vaste majorité des poissons pêchés restent en-dessous des limites autorisées pour la consommation, même si les autorités japonaises les ont resserrées en avril 2012.
Buesseler souligne en outre, dans le numéro de Science daté de vendredi, que les niveaux de contamination dans presque toutes les espèces de poissons et crustacés ne diminuent pas. Mais ces niveaux varient selon les espèces, ce qui complique la réglementation par les pouvoirs publics.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités