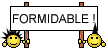@"dynamite": On peut aussi ajouter a l'absence de réaction des libertaires: l'affaire dreyfus, le positionnement de Faure en soutien à Dreyfus n'a pas fait de nous des pratiquants ni des militaires non? On peut y ajouter l’absence de réaction politique face au colonialisme, à part les réactions outrées aux massacres de masse. Combien de temps aussi pour en finir avec la misogynie d'un ferré ou de tant d'autres dans nos milieu et la reconnaissance de la lutte pour l'égalité des femmes EN LEUR LAISSANT en premier lieu cette démarche. Le refus de participer a la résistance l'a été pour des raisons de pacifisme intégral et de refus du nationalisme, quand on voit que les exilés espagnols et les trotskystes (pourtant sur les même positions sur le nationalisme) ont pris le maquis on peut s'interroger sur le grand écart entre la réalité et le dogme chez les libertaires.
Dans le texte, La question est surtout les conditions réelles d’existence du racisme et là les formes que prennent le racisme anti arabe, comme on peut parler de volonté d’assimiler et de sédentariser les cultures nomades, que c’est bien la dedans que nait le racisme anti roms / anti manouche / anti tsigane / anti gitan sans pour autant devenir évangélistes ou catholiques...
Le racisme n'est pas un mal qui tombe sur les gens au hasard en fonction de leur tête de beauf, c'est un système qui le permet et l'alimente, comme le sexisme provient de bien d'autres choses que du prototype du macho.
Le combattre c'est lutter au delà de l'humanisme pur, c'est lutter dans les conditions réelles de la société telle qu'elle est.
Et les études post coloniales n'ont pas été inventées par LMSI ni par le PIR comme les études de genre n'ont pas été inventées par Timult.
Bien qu'imparfait, c'est pour les même raisons que fred que j'ai signé ce texte. Je n'y vois d'ailleurs absolument pas le refus d'une critique des religions... mais puisqu'il faut être binaire. Ni par "opportunisme", je ne le fais pas par rapport à un constat pessimiste sur le mouvement anar.
@meluzine et geekmou, Sur l'UJFP: moi ca m’intéresse de savoir ce qui s'est passé réellement parce qu'une personne de l'UJFP ne représente pas nécessairement l'ensemble de l'organisation. Et parce que la date en soutien a RAWA a Rennes elle a été porté par des camarades féministes ( dont une copine musulmane...) qui, pour une grosse partie, se sentent tout a fait d'accord avec ce texte.
A contretemps N° 9 septembre 2002 http://www.acontretemps.plusloin.org
L’Affaire des anarchistes
Sébastien FAURE
Les Anarchistes et l’affaire Dreyfus (Présentation de Philippe Oriol)
(Editions CNT, 88 p., 2002).
UBLIE en février 1898 dans le Libertaire, en quatre livraisons, avant de paraître, dans la foulée, en
brochure, le texte de Sébastien Faure, les Anarchistes et l’affaire Dreyfus, reflète sa position et celle de
ses amis à un moment de leur combat dreyfusard – ou dreyfusiste comme on disait alors. D’autres
anarchistes, en revanche, et non des moindres – Jean Grave, Emile Pouget – adoptèrent des positions
sensiblement différentes, et toutes se nuancèrent ou évoluèrent au fil du temps. C’est à l’analyse de cette
diversité libertaire que s’attache Philippe Oriol dans une très fine présentation du texte de S. Faure, qui rend
cette réédition encore plus opportune et à laquelle nous accorderons nos faveurs.
« L’histoire, écrit P. Oriol, n’a pas retenu ce que fut l’engagement des anarchistes dans l’affaire
Dreyfus. » Pas davantage qu’elle n’a gardé en mémoire les propos laudatifs de Charles Péguy sur ces
hommes qui « seuls firent leur devoir… et firent mieux qu’ils n’étaient tenus à faire comme anarchistes ». Ils
le firent non pour défendre l’officier, mais pour s’opposer – et vigoureusement – à la machination dont il fut
victime et à l’« infâme coalition » réactionnaire qui l’orchestra.
A juste titre, P. Oriol insiste sur la nécessité d’étudier sur la durée (1894-1899) l’implication des
anarchistes dans l’Affaire pour y percevoir les évolutions. Quand elle éclate, le mouvement libertaire est au
plus bas : le procès des Trente vient de s’achever (juillet 1894), les « lois scélérates » criminalisent ses
militants, sa presse est interdite ou sabordée. On admettra aisément que, dans ces conditions, le sort d’un
galonné victime de ses pairs n’ait pas été au premier rang des préoccupations des libertaires. Que Dreyfus fût
juif – et « traître » parce que juif – n’attira pas davantage leur attention. L’antisémitisme les laissait, au
mieux, indifférents et P. Oriol fournit quelques exemples de cette « totale aberration » – commune aux
différentes écoles du socialisme – qui légitimait le « délirant glissement sémantique » du « juif » au
« capitaliste » et peuplait, entre autres, les pages du Père peinard d’E. Pouget, de nauséabonds « youtre » et
« youpin ». S. Faure avouera plus tard : « Nous avons eu le très grand tort de ne nous élever ni assez tôt, ni
assez vigoureusement contre le courant antisémitique. » Ce fut sans doute son principal mérite.
On sait le rôle que joua Bernard Lazare – dont P. Oriol annonce, pour l’année prochaine, une biographie
qu’on lira avec intérêt. En dénonçant avant tout le monde l’erreur judiciaire, il lança l’Affaire. Quand il
publie son premier mémoire en défense, en 1896, la presse anarchiste est, depuis un an, de nouveau autorisée
à paraître. Alors que les Temps nouveaux de J. Grave n’accordent que peu d’intérêt aux arguments de B.
Lazare, le Libertaire de S. Faure ne tarde pas à lui emboîter le pas, en s’occupant d’abord de convaincre les
compagnons réticents de l’importance du combat à mener. « Cette prise de conscience, note P. Oriol, ne se
fit pas sans difficultés, sans atermoiements, sans ruptures. » La révélation, en novembre 1897, de la
responsabilité d’Esterhazy et la publication du second mémoire de B. Lazare, Une erreur judiciaire.
L’affaire Dreyfus changent la donne : l’erreur devient machination. De plus en plus actifs, S. Faure et ceux
du Libertaire s’engagent dans la bataille pour la révision du procès. De leur côté et chacun dans leur style, J.
Grave et E. Pouget s’en tiennent toujours aux principes : l’anarchisme doit se situer avec détermination audessus
de la mêlée car il aurait tout à perdre à s’y plonger.
Passionnante se révèle, sous la plume de P. Oriol, la confrontation entre ces deux positions antagonistes
et, finalement, assez typiques d’une permanente hésitation de l’anarchisme face au réel. S’y inclure ? S’en
exclure ? L’histoire de ce mouvement de pensée et d’action fourmille d’exemples où le même dilemme se
représenta. Ce qui fait sans doute la singularité de cet épisode, c’est, d’une part, le progressif ralliement des
rétifs (dont E. Pouget, mais pas J. Grave) à la cause des dreyfusards et, de l’autre, les illusions politiques
qu’il induisit au sein du mouvement anarchiste – certains n’hésitant pas à parler de dérive.
Il est difficilement contestable, en effet, qu’en fournissant, en 1898, le gros des manifestants dreyfusards,
les anarchistes, qu’on le veuille ou non, ralliaient aussi le camp d’une fraction de la bourgeoisie contre
l’autre et, davantage que les principes – qui peuvent être, comme chacun sait, modulables –, ils
abandonnaient leur terrain naturel, celui de la lutte de classe. L’expérience du Journal du peuple, quotidien
fondé et dirigé par S. Faure grâce au financement de la communauté juive, reste très révélatrice de cette
« républicanisation » de l’anarchisme dreyfusard. Outre qu’elle entraîne concomitamment la cessation
P
A contretemps N° 9 septembre 2002 http://www.acontretemps.plusloin.org
volontaire de parution du Libertaire et du Père peinard – J. Grave, lui, maintient les Temps nouveaux –, elle
signe son intégration, même critique, au bloc républicain.
Cela dit, et quel que soit le jugement porté, il n’en demeure pas moins qu’on ne voit pas quel autre choix
s’offrait aux anarchistes que celui de la justice contre l’ordre et de la victime contre le bourreau . Nul autre,
soutint S. Faure, nul autre qui ne compromît l’idée anarchiste elle-même. Cette thèse, les compagnons
finirent par l’adopter très majoritairement et par s’y tenir. Ils n’y gagnèrent finalement pas grand-chose, sauf
l’honneur, et, nous dit P. Oriol, « une manière de légitimité » provisoire. Provisoire, car, sitôt l’affaire
terminée, les dreyfusards se chargèrent de les remettre à leur place : en face. Et ils se retrouvèrent presque
seuls à défendre leurs innocents – Durand et Rousset, par exemple – dont le sort n’émut pas outre mesure
ces intellectuels que l’Affaire venait pourtant de promouvoir au rang de dignes représentants de la
conscience humaine.